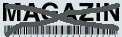Kropotkin – La prochaine révolution
Script
Part I
Décidément, nous marchons à grands pas vers la révolution, vers une commotion qui, éclatant dans un pays, va se propager dans tous les pays voisins, et secouant la société actuelle jusque dans ses entrailles.
Il y a des époques dans la vie de l’humanité, où la nécessité d’une secousse formidable, d’un cataclysme s’impose sous tous les rapports à la fois. À ces époques, tout homme de cœur commence à se dire que les choses ne peuvent plus marcher ainsi ; qu’il faut de grands événements qui viennent rompre brusquement le fil de l’histoire, jeter l’humanité hors de l’ornière où elle s’est embourbée et la lancer dans les voies nouvelles, vers l’inconnu. On sent la nécessité d’une révolution, immense, implacable, qui vienne, non seulement bouleverser le régime économique, non seulement renverser l’échelle politique, mais aussi remuer la société dans sa vie intellectuelle et morale, secouer la torpeur, refaire les mœurs.
Un besoin de vie nouvelle se fait sentir. Le code de moralité établi, celui qui gouverne la plupart des hommes dans leur vie quotidienne ne paraît plus suffisant. On s’aperçoit que telle chose, considérée auparavant comme équitable, n’est qu’une criante injustice : la moralité d’hier est reconnue aujourd’hui comme étant d’une immoralité révoltante. Le conflit entre les idées nouvelles et les vieilles traditions éclate dans toutes les classes de la société, dans tous les milieux, jusque dans le sein de la famille. Les enfants entrent en lutte avec leurs parents : Le fils trouve révoltant ce que son père trouvait tout naturel durant toute sa vie ; la fille se révolte contre les principes que sa mère lui transmettait comme le fruit d’une longue expérience.
À ces époques, où la médiocrité orgueilleuse étouffe toute intelligence qui ne se prosterne pas devant les pontifes, où la moralité du juste-milieu fait la loi, et la bassesse règne victorieuse, — à ces époques la révolution devient un besoin ; les hommes honnêtes de toutes les classes de la société appellent la tempête, pour qu’elle vienne brûler de son souffle enflammé la peste qui nous envahit, emporter la moisissure qui nous ronge, enlever dans sa marche furieuse tous ces décombres du passé qui nous surplombent, nous étouffent, nous privent d’air et de lumière, pour qu’elle donne enfin …
Dans l’usine suffocante, comme dans la sombre gargote, sous le toit du grenier, comme dans la galerie ruisselante de la mine, s’élabore tout un monde nouveau. Dans ces sombres masses, que la bourgeoisie méprise autant qu’elle les craint, les problèmes les plus ardus de l’économie sociale et de l’organisation politique viennent se poser l’un après l’autre, se discutent et reçoivent leurs solutions nouvelles. On tranche dans le vif des plaies de la société actuelle. De nouvelles aspirations se produisent, de nouvelles conceptions s’ébauchent.
Les opinions s’entre-croisent, varient à l’infini : mais deux idées premières résonnent déjà de plus en plus distinctement dans ce bourdonnement des voix : l’abolition de la propriété, le communisme d’une part ; d’autre part, l’abolition de l’État, la Commune libre, l’union internationale des peuples travailleurs.
L’homme comprend de plus en plus que le bonheur de l’individu isolé n’est plus possible ; qu’il ne peut être cherché que dans le bonheur de tous, — le bonheur de la race humaine.
Part II
„Mais on l’a si souvent annoncée, cette révolution! Moi-même j’y ai cru un moment, et pourtant elle n’arrive pas !“
Le 18 mars 1871, le peuple de Paris se soulevait contre un pouvoir généralement détesté et méprisé, et proclamait la ville de Paris indépendante, libre, s’appartenant à elle-même. Ce renversement du pouvoir central se fit même sans la mise en scène ordinaire d’une révolution : ce jour, il n’y eut ni coups de fusil, ni flots de sang versé derrière les barricades. Les gouvernants s’éclipsèrent devant le peuple armé, descendu dans la rue : la troupe évacua la ville, les fonctionnaires s’empressèrent de filer sur Versailles. Le gouvernement s’évapora, comme une mare d’eau putride au souffle d’un vent de printemps, et le 19, Paris, se trouva libre de la souillure qui empestait la grande cité.
Ces combattants ne se rendirent pas compte de la révolution qu’ils inauguraient, de la fécondité du nouveau principe qu’ils cherchaient à mettre en exécution.
La Commune de 1871 ne pouvait être qu’une première ébauche. Née à l’issue d’une guerre, cernée par deux armées prêtes à se donner la main pour écraser le peuple, elle n’osa se lancer entièrement dans la voie de la révolution économique ; elle ne se déclara pas socialiste, ne procéda ni à l’expropriation des capitaux ni à l’organisation du travail. Elle ne rompit pas non plus avec la tradition de l’État, du gouvernement représentatif.
Certes, si nous nous bornions à observer seulement les faits réels et palpables accomplis par la Commune, nous devrions dire que cette idée n’était pas suffisamment vaste, qu’elle n’embrassait qu’une partie minime du programme révolutionnaire. Mais si nous observons, au contraire, l’esprit révolutinaire, les tendances qui cherchaient à se faire jour et qui n’eurent pas le temps de passer dans le domaine de la réalité, parce que, avant d’éclore, elles furent étouffées sous des monceaux de cadavres, — nous comprendrons alors toute la portée du mouvement et les sympathies qu’il inspire au sein des masses ouvrières dans les deux mondes. La Commune enthousiasme les cœurs, non par ce qu’elle a fait, mais par ce qu’elle promet de faire un jour.
Ce fut seulement lors de l’application pratique que l’on commença à en entrevoir la portée future ; ce fut seulement dans le travail de la pensée qui s’opéra depuis, que ce nouveau principe se précisa de plus en plus et se détermina.
Sous le nom de Commune de Paris, naquit une idée nouvelle, appelée à devenir le point de départ des révolutions futures.
Part III
Il répugne à l’esprit humain de se lancer dans une œuvre de démolition sans se faire une idée — ne fût-ce que dans quelques traits essentiels, — de ce qui pourrait remplacer ce qu’on va démolir.
Si on eût questionné tous ceux qui travaillèrent à l’avènement de la Commune sur ce qu’il y avait à faire, quelle terrible cacophonie de réponses contradictoires eût-on reçu ! Fallait-il prendre possession des ateliers au nom de la Commune ? Pouvait-on toucher aux maisons et les proclamer propriété de la cité insurgée ? Fallait-il prendre possession de toutes les vivres et organiser le rationnement ? Fallait-il proclamer toutes les richesses entassées propriété commune du peuple et appliquer ces moyens puissants à l’affranchissement ? — Sur aucune de ces questions il n’y avait d’opinion formée au sein des révolutionnaires.
Le jour de la révolution, le collectiviste-étatiste, le social démocrate courra au parlement, d’où il lancera ses décrets sur le régime de la propriété ; il cherchera à se constituer un gouvernement formidable, fourrant son nez partout, jusqu’à statistiquer et décréter le nombre de poules élevées dans le plus petit village. Le communaliste-autonomiste courra de même à l’Hôtel-de-Ville et, s’instituant, lui aussi, gouvernement. Il défendra de toucher à la sainte propriété tant que le Conseil de la Commune n’aura pas jugé opportun de le faire. Tandis que le communiste-anarchiste proclamera le principe, que l’on ne doit pas se préoccuper du parlement et de la municipalité. Les ouvriers iront prendre possession sur-le-champ, des ateliers, des maisons, des greniers à blé, bref de toute la richesse sociale. Le communiste-anarchiste ne votera aucun „gouvernement révolutionnaire“, mais cherchera à organiser dans chaque commune, dans chaque groupe, la production et la consommation en commun.
L’idée est que l’organisation ouvrière pour la production, l’échange et la distribution s’approprie la place de l’exploitation capitaliste et de l’État existant.
En cela, tous les biens deviendront immédiatement dès le début du bouleversemment social à la disposition gratuite de tous.
Que chacun prenne dans le tas ce dont il a besoin et soyons sûrs que, dans les greniers de nos villes, il y aura assez de nourriture pour nourrir tout le monde jusqu’au jour où la production libre prendra sa nouvelle marche. Dans les magasins de nos villes, il y a assez de vêtements pour vêtir tout le monde. Il y a même assez d’objets de luxe pour que tout le monde en choisisse à son goût.
Installez-vous dans les palais et les hôtels et faites un feu de joie des amas de briques et de bois vermoulu qui furent vos logis. L’instinct de destruction, si naturel et si juste parce qu’il est en même temps l’instinct du renouvellement, trouvera largement à se satisfaire. Que de vieilleries à remplacer ! Tout n’est-il pas à refaire, les maisons, les villes, l’outillage agricole et industriel, enfin le matériel de la société tout entière ?
Pouvons-nous admettre, ne fût-ce que pour un moment, que cet immense travail de révision et de réformation puisse s’apaiser par un simple changement de gouvernement ?
La commune, qui s’établit aujourd’hui dans notre siècle de chemins de fer et de télégraphes, de science cosmopolite, fera mieux. Elle sera en vérité, autrement que par le nom, une commune. Révolutionnaire en politique, elle le sera dans les questions de production et d’échange.
Elle sait qu’il ne peut y avoir de terme moyen : ou bien la Commune sera absolument libre de se donner toutes les institutions qu’elle voudra, ou bien elle restera ce qu’elle a été jusqu’aujourd’hui, une simple succursale de l’État enchaînée dans tous ses mouvements. Elle sait qu’elle doit briser l’État et le remplacer par la Fédération et elle agira en conséquence.
La prochaine révolution aura un caractère de généralité qui la distinguera des précédentes. Ce ne sera plus un pays qui se lancera dans la tourmente, ce seront les pays.
Une petite commune ne pourrait vivre huit jours sans être obligée, par la force des choses, de se mettre en relations suivies avec les centres industriels, commerciaux, artistiques, et ces centres, à leur tour, sentiraient le besoin d’ouvrir leurs portes toutes grandes aux habitants des villages voisins, des communes environnantes et des cités lointaines.
Grâce à la variété infinie des besoins, tous les lieux habités ont déjà plusieurs centres auxquels ils se rattachent et, à mesure que leurs besoins se développeront, ils se rattacheront à de nouveaux centres qui pourront subvenir à des nécessités nouvelles.
Prenez un atlas économique de n’importe quel pays et vous verrez qu’il n’existe pas de frontières économiques : les zones de production et d’échange de divers produits se pénètrent mutuellement, s’enchevêtrent, se superposent. De même, les fédérations de Communes viendraient bientôt s’enchevêtrer, se croiser, se superposer et former ainsi un réseau bien autrement compact.
Ce réseau se compose d’une multitude d’associations, qui se confédèrent pour tous les besoins que demande un travail collectif : en groupements pour toutes les formes de production, agricole, industrielle, purement intelectuelle ou artistique, en groupements consommateurs qui se chargent du logement, de l’éclairage et du chauffage, de la nourriture, des sanitaires, etc. Tous ces groupes agissent ensemble dans un accord libre et mutuel.
Pour nous, « Commune » n’est plus une agglomération territoriale ; c’est plutôt un nom générique, un synonyme de groupements d’égaux, ne connaissant ni frontières ni murailles. La Commune sociale cessera bien vite d’être un tout nettement défini. Chaque groupe de la Commune sera nécessairement attiré vers d’autres groupes similaires des autres Communes ; il se groupera, se fédérera avec eux par des liens tout au moins aussi solides que ceux qui le rattachent à ses concitadins, constituera une Commune d’intérêts dont les membres sont disséminés dans mille cités et villages.
Ce seront des millions de communes non plus territoriales, mais se tendant la main à travers les fleuves, les chaînes de montagnes, les océans, unissant les individus disséminés aux quatre coins du globe et les peuples en une seule et même famille d’égaux.
Cette nouvelle société consiste en membres de même titre, qui ne sont plus forcés de vendre à d’autres, main et tête et celle-ci de se laisser exploiter arbitrairement, sans plan, par ceux-la. Ils peuvent plutôt porter prévisionellement leurs connaissances et leurs capacités vers la production dans le cadre d’un organisme, qui, dans le même temps, laisse à l’initiative individuelle toute latitude.
Part IV
„Tout ce que vous affirmez est très juste. Votre idéal de communisme anarchiste est excellent et sa réalisation amènerait en effet le bien-être et la paix sur la terre ; mais, combien peu le désirent, et combien peu le comprennent, et combien peu ont le dévouement nécessaire pour travailler à son avènement ! Vous n’êtes qu’une petite minorité, faibles groupes disséminés çà et là, perdus au milieu d’une masse indifférente, et vous avez devant vous un ennemi terrible, bien organisé, possédant armées, capitaux, instruction. La lutte que vous avez entreprise est au-dessus de vos forces.“
Que nos groupes anarchistes ne soient qu’une petite minorité en comparaison des dizaines de millions qui peuplent la France, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, — rien de plus vrai. Tous les groupes représentant une idée nouvelle ont toujours commencé par n’être qu’une minorité. Et il est fort probable que comme organisation, nous resterons minorité jusqu’au jour de la révolution. Mais, est-ce un argument contre nous? — En ce moment, ce sont les opportunistes qui sont la majorité : devrions-nous, par hasard, devenir aussi opportunistes?
L’histoire est là pour nous dire que ceux qui ont été minorité la veille de la révolution, deviennent force prédominante le jour de la révolution, s’ils représentent la vraie expression des aspirations populaires et si la révolution dure un certain temps, pour permettre à l’idée révolutionnaire de se répandre, de germer et de porter ses fruits. Car, ne l’oublions pas, ce n’est pas par une révolution d’un jour ou deux que nous arriverons à transformer la société dans le sens du communisme anarchiste ; un soulèvement de courte durée peut bien renverser un gouvernement pour en mettre un autre à sa place. Mais il ne change rien aux institutions fondamentales de la société. C’est toute une période insurrectionnelle de trois, quatre, cinq ans peut-être, que nous devrons traverser pour accomplir notre révolution dans le régime de la propriété et le mode de groupement de la société. Il a fallu cinq ans d’insurrection en permanence, depuis 1788 jusqu’en 1793, pour abattre en France le régime féodal foncier et l’omnipotence de la royauté : il en faudra bien trois ou quatre pour abattre la féodalité bourgeoise et l’omnipotence de la ploutocratie.
Ce serait une erreur funeste de croire que l’idée d’expropriation ait déjà pénétré dans les esprits de tous les travailleurs. Loin de là. Il y a des millions qui n’en ont pas entendu parler, sinon par la bouche des adversaires. Nous savons, il est vrai, que c’est surtout lors de la révolution même que l’idée de l’expropriation fera le plus d’adhérents, lorsque tout le monde s’intéressera à la chose publique, lira, discutera, agira, et lorsque les idées les plus concises et les plus nettes seront surtout capables d’entraîner les masses.
C’est surtout pendant cette période d’excitation, quand l’esprit humain travaille avec une vitesse accélérée. Dans un tel moment il adoptera l’idée anarchiste, semée dès aujourd’hui par les groupes existants. C’est alors que les indifférents d’aujourd’hui deviendront partisans convaincus de l’idée.
Rappelons-nous quel triste tableau offrait la France quelques années avant cette révolution et quelle faible minorité étaient ceux qui rêvaient l’abolition de la royauté et de la féodalité.
C’est d’un désespoir profond que sont inspirés les quelques rares révolutionnaires de l’époque lorsqu’ils jettent un regard autour d’eux, et Camille Desmoulins disait avec raison cette parole célèbre : — « Nous étions à peine une douzaine de républicains à Paris avant 1789. »
Durant toute l’année 1788, ce ne sont que petites émeutes partielles des paysans ; comme les petites grèves partielles d’aujourd’hui, elle éclatent çà et là sur la surface, mais peu à peu elles s’étendent, se généralisent, deviennent plus âpres, plus difficiles à vaincre.
Il en sera de même pour la révolution dont nous prévoyons l’approche. L’idée du communisme anarchiste, représentée aujourd’hui par de faibles minorités, mais se précisant de plus en plus, fera son chemin dans la grande masse.
Tantôt lugubre, tantôt railleuse, mais toujours audacieuse ; tantôt collective, tantôt purement individuelle, elle ne néglige aucun des moyens qu’elle a sous la main, aucune circonstance de la vie publique, pour tenir toujours l’esprit en éveil, pour propager et formuler le mécontentement, pour exciter la haine contre les exploiteurs, ridiculiser les gouvernants, démontrer leur faiblesse, et surtout, et toujours, réveiller l’audace, l’esprit de révolte, en prêchant d’exemple.
Il se peut qu’au premier abord la masse soit indifférente. Tout en admirant le courage de l’individu ou du groupe initiateur, il se peut qu’elle veuille suivre d’abord les sages, les prudents, qui s’empressent de taxer cet acte de « folie » et de dire que « les fous, les têtes brûlées vont tout compromettre. » Ils avaient si bien calculé, ces sages et ces prudents, que leur parti, en poursuivant lentement son œuvre, parviendrait dans cent ans, dans deux cents ans, trois cents ans peut-être, à conquérir le monde entier — et voilà que l’imprévu s’en mêle ; l’imprévu, bien entendu, c’est ce qui n’a pas été prévu par eux, les sages et les prudents. À partir de cet instant, l’indifférence est désormais impossible. Ceux qui, au début, ne se demandaient même pas ce que veulent les « fous », sont forcés de s’en occuper, de discuter leurs idées, de prendre parti pour ou contre. Par les faits qui s’imposent à l’attention générale, l’idée nouvelle s’infiltre dans les cerveaux et conquiert des prosélytes.
La réalisation de cette idée, éclatant en même temps sur mille points du territoire, empêchera l’établissement d’un gouvernement quelconque qui puisse entraver les événements et la révolution sévira jusqu’à ce qu’elle ait accompli sa mission : l’abolition de la propriété individuelle et de l’État.